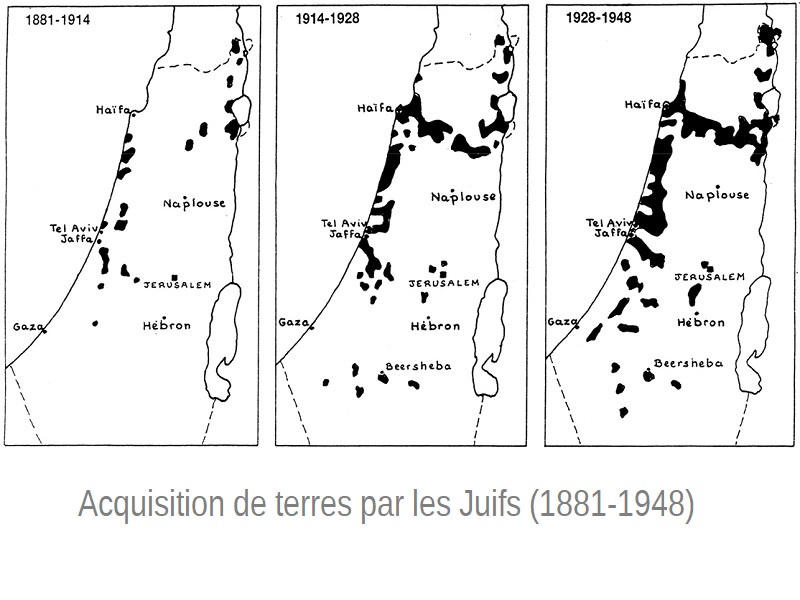La démocratie mise à mal
Nous connaissons une crise de régime, une crise constitutionnelle, celle d’une 5e République à bout de souffle qui n’arrive plus combler l’écart entre les institutions et le pays réel.
Mais au-delà, nous assistons à une crise des représentations politiques dont la montée de l’abstention et « la confiance » dans les partis politiques sont les manifestations les plus visibles. On peut certes se satisfaire que la création de la NUPES ait empêché la disparition de la gauche. Mais, force est de constater que la base électorale de celle-ci s’est érodée au point de ne représenter que le quart des votants avec la moitié des électeurs qui s’abstiennent… dans les couches populaires
Ce recul se situe dans un contexte plus général de recul de la démocratie, d’un déclin des régimes démocratiques avec la montée des solutions autoritaires (Trump, Bolsonaro, les illibéraux dans l’UE, la montée des extrêmes-droites, etc. mais aussi l’échec des printemps arabes victimes d’une répression féroce comme en Syrie, en Égypte).
Une réponse à la crise, en termes de renouveau démocratique, ne va pas de soi. Ce d’autant plus que le libéralisme autoritaire mine, lui aussi, l’idée de démocratie. Quant au social-libéralisme, guère différent du précédent, il a accrédité l’idée de l’impuissance politique à transformer la vie des gens « la politique, ce n’est pas pour nous ».
Depuis la FASE avec le texte « Osons la révolution démocratique » jusqu’à la brochure d’ENSEMBLE! sur la démocratie, nous avons mis la démocratie au centre d’un processus révolutionnaire de transformation de la société. Il ne s’agit pas seulement d’appeler à voter pour un programme de transformation démocratique, pour une nouvelle constitution, mais aussi d’étendre le champ démocratique, y compris dans l’entreprise et les services publics et les institutions sociales, tout en favorisant les initiatives citoyennes.
Un mai rampant ?
À la surprise des commentateurs et des spécialistes, le mouvement d’opposition au projet du gouvernement sur les retraites, à initiative d’une intersyndicale inédite, s’est inscrit dans la durée. Ce qui permet cette durée, c’est bien sûr le soutien sans précédent d’une majorité de la population et de 9 actifs sur 10. Nous avons assisté à une déconstruction de masse de la légitimité de cette contre-réforme qui fait qu’avec le temps l’opposition s’est renforcée.
Certains (au-delà du seul gouvernement) misaient sur un épuisement rapide des salarié·es sous la contrainte d’une inflation qui renchérissait le coût des journées de grève. Là encore, nous avons connu une baisse des journées de grève, mais c’est loin d’être un arrêt. Les journées d’appel à manifester donnent lieu à remobilisation et des secteurs restent en gréve longtemps.
Contrairement aux mythes qui courent, le mouvement gréviste est plus fort qu’en 1995. À l’époque, celui-ci se concentrait sur les seuls cheminots. Par contre, la forme principale d’action pour la majorité reste la manifestation de rue, une occupation-réappropriation collective de l’espace public qui finit pas être insupportable aux dirigeant·es. Nous ne devons pas être victimes de leurs discours : ce ne sont pas les quelques « cassures » qui les inquiètent, mais cette présence massive de l’opposition à la loi dans la rue (il faudrait pousser plus loin l’analyse de leur inquiétude : conséquences pour l’image de la France auprès des marchés financiers ? perturbations de la production ? autre ?)
Le vote (le non-vote !) de la loi n’a pas arrêté les mobilisations. Au contraire, le recours au 49.3 est venu ajouter une dimension démocratique à l’exigence de retrait.
Celles et ceux qui spéculent sur un coup d’arrêt en cas de validation par le Conseil constitutionnel feraient bien de se méfier. Il n’est pas du tout sûr qu’une telle décision mette un terme au mouvement actuel. Nous pourrions bien assister à un mouvement qui s’inscrive dans une durée encore plus longue pour rentrer dans un processus encore inédit en France où les grands conflits sociaux sont restés limités dans le temps.
Il serait bon de se rappeler qu’à la fin des années 1960, l’Italie a connu un « Maggio strisciante » qui a duré au-delà de ce qu’a duré le Mai français pour couvrir plusieurs années. C’est un moment historique qui réalisa la conjonction de deux mouvements de lutte jusque-là restés séparés. D’une part la contestation des institutions et des rôles traditionnels, d’autre part une critique du travail et la mise en cause de sa centralité au sein du rapport social capitaliste.
N’y a-t-il pas quelques similitudes ? Ne faut-il pas se préparer à une telle perspective ? Et à ce qui a suivi en Italie avec les années de plomb orchestrées par les Darmanin locaux ? Et à ce qui s’est passé dans une gauche italienne dominée par un PCI très fort, mais qui n’a pas su (pu) proposer une alternative ?

Grève de masse, partis et syndicats
Nous avions toutes et tous dans la tête l’idée qu’un blocage économique pourrait seul faire pression sur le patronat pour l’obliger à faire reculer le gouvernement. Ce schéma s’est vérifié dans des moments revendicatifs passés (la référence à 1995 est vivante dans la mémoire collective). C’est pourquoi le mot d’ordre de « grève générale » a été avancé, y compris sous la forme de « grèves reconductibles » devant s’élargir.
Même dans les temps les plus forts, il n’y a pas eu de grève générale. Les grèves reconductibles sont restées limitées à certains secteurs avec des mobilisations réelles. Mais le pays n’a pas été mis à l’arrêt.
Certains mettent en cause la stratégie de l’intersyndicale qui serait responsable d’une démobilisation en étalant, par exemple, trop dans le temps les journées d’action. Mais comment alors expliquer le maintien des grandes manifestations ?
La grande différence avec 1995 n’est pas l’importance des grèves qui en 1995 sont aussi restées limitées, mais l’effet de ces grèves sur la production et les échanges. En 1995, la SNCF (et la RATP) était encore centrales dans la logistique de production. Elles avaient pour fonction de conduire les salarié.es au boulot, surtout en région parisienne. La SNCF jouait encore un rôle central dans le fret, ce qui pouvait gêner les approvisionnements et les entreprises. En 1996, la grève des routiers a obtenu des résultats pour les mêmes raisons. Aujourd’hui, les réorganisations capitalistes des chaines de production ont réduit l’efficacité des seul·es cheminot·es pour bloquer le pays.
Mais ce n’est là qu’un aspect : comme outils de lutte du salariat, les syndicats ont eu du mal à suivre l’évolution des entreprises et du salariat (y compris sous ses formes non-salariées, Uber et autres autoentrepreneurs). Les bastions syndicaux des grandes unités de production sont, en partie, remplacés par tout un système de sous traitance, de recours à des indépendant·es, etc.
Dans tous ces secteurs, la grève est quasiment interdite comme dans les petites boites, dans des secteurs de l’aide aux personnes ou dans l’hôtellerie-restauration… Dans nombre de PME-TPE, le syndicalisme est interdit et c’est là que se trouve la majorité des ouvriers. Presque un tiers du salariat subit la précarité. Les réformes de Macron sur l’assurance chômage ne font qu’aggraver la situation des précaires. Dans les boites, on le sait bien, les CDD et les intérimaires ne font pas grève !
Comment exercer une pression économique dans ces conditions, c’est une discussion stratégique à avoir. Sans doute, les blocages des circuits logistiques sont un élément de réponse, mais leur mise en œuvre efficace se heurte à la faiblesse du syndicalisme, particulièrement interprofessionnel (là, la différence avec 1995 est particulièrement sensible).
Partis, syndicats, travailleuses et travailleurs
Bien sûr, il y a des tentatives pour prendre en charge ces nouvelles réalités dans les organisations syndicales, ce qui explique leur rôle moteur dans ces mouvements. Des secteurs professionnels nouveaux sont présents dans les manifestations.
Mais les syndicats n’ont pas encore les moyens organisationnels pour faire face aux enjeux. Ils se sont plutôt montrés à la hauteur de la situation et d’un conflit ouvert avec un gouvernement dur. Leur popularité se reconstitue progressivement dans ce conflit, ce qui montre que rien n’est perdu malgré des années de réduction des droits.
Du côté politique, il n’en est pas de même : le terrain de la crise du travail est trop peu pris en compte. Il y a trop peu d’efforts d’élargissement de la base sociale de la NUPES vers les précaires et les salarié·es atypiques (Hors CDI à temps plein) devenu·es majoritaires. C’est là pourtant une tache prioritaire dans les mois qui viennent. Pour les combattre efficacement, pour répondre aux exigences sociales, comment prendre en compte les nouvelles formes de rapports sociaux capitalistes et leurs conséquences sur les travailleur·euses ?
Nous ne partons pas de rien pour leur parler à elles, à eux et à tous·tes les autres : réduction du temps de travail (y compris sur la durée de la vie), droits nouveaux dans les entreprises sur l’organisation et les finalités du travail (y compris application aux petites boites des droits existants), nouveau statut du travail salarié. Autant d’objectifs qui lient revendications et projet de société !
Trop souvent, ces revendications sont passées sous silence et ne donnent pas lieu aux débats publics nécessaires.
C’est aussi là, comme sur la démocratie, que se joue notre capacité commune à être une alternative face au libéralisme autoritaire et au RN.
Étienne Adam
11 avril 2023